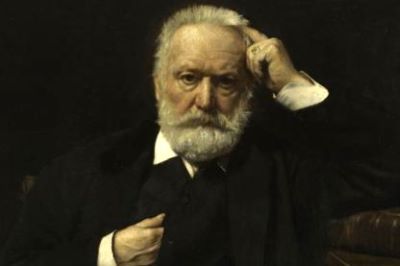L’Espagne de Victor… (2)
En 1843, Hugo fit un second voyage en Espagne avec sa maîtresse, Juliette Drouet.
L’arrivée en Espagne fut décevante : « Où la maison de France a épousé la maison d’Autriche, où Mazarin, l’athlète de l’astuce, a lutté corps à corps avec Louis de Haro, l’athlète de l’orgueil, une vache broute l’herbe. »
Irún lui fit une impression semblable et Hugo eut l’impression d’avoir été floué : « C’est là que l’Espagne m’est apparue pour la première fois et m’a si fort étonné, avec ses maisons noires, ses rues étroites, ses balcons de bois et ses portes de Forteresse, moi l’enfant français élevé dans l’acajou de l’empire […]. Hélas ! Irún n’est plus Irún. Irún est maintenant plus empire et plus acajou que Paris. Ce ne sont que maisons blanches et contrevents verts. On sent que l’Espagne, toujours arriérée, lit Jean-Jacques Rousseau en ce moment. Irún a perdu toute sa physionomie. Ô villages qu’on embellit, que vous devenez laids ! Où est l’histoire ? où est le passé ? où est la poésie ? où sont les souvenirs ? Irún ressemble aux Batignolles. »
Puis vint la contemplation de la beauté de San Sebastián, « une ville nouvelle aussi régulière qu’un plateau d’échiquier, peut-être trop parfaite » : « On est à peine espagnol à Saint-Sébastien ; on est basque […]. On naît basque, on parle basque, on vit basque et l’on meurt basque. La langue basque est une patrie, j’ai presque dit une religion. »
Lors d’une balade, le poète se livra aux rêves éveillés du promeneur solitaire :
« Une route s’était présentée, je l’avais acceptée au hasard, et j’allais. Je marchais dans la montagne sans trop savoir où j’étais ; peu à peu le paysage extérieur, que je regardais vaguement, avait développé en moi cet autre paysage intérieur que nous nommons la rêverie ; j’avais l’œil tourné et ouvert au dedans de moi, et je ne voyais plus la nature, je voyais mon esprit. »
Ses déambulations le menèrent à un point de vue fascinant :
« Cet endroit magnifique et charmant comme tout ce qui a le double caractère de la joie et de la grandeur, ce lieu inédit qui est un des plus beaux que j’aie vus et qu’aucun « touriste » ne visite, cet humble coin de terre et d’eau qui serait admiré s’il était en Suisse et célèbre s’il était en Italie, et qui est inconnu parce qu’il est en Guipuzcoa, ce petit éden rayonnant où j’arrivais par hasard, et sans savoir où j’allais, et sans savoir où j’étais, s’appelle en espagnol Pasages et en français le Passage. »
Le poète décida de s’installer à Pasajes avec Juliette. Les habitants de San Sebastián trouvèrent qu’il s’agissait là d’un scandale : ils pensèrent qu’Hugo avait perdu la tête quand il décida de se fixer dans un tel trou perdu. La description de la vue qu’il avait depuis le balcon confirme la qualité du goût de ce voyageur :
« Tout autour de la baie, un large demi-cercle de collines dont les ondulations vont se perdre à l’horizon et que dominent les faîtes décharnés du mont Arun […]. Le ciel a toutes les nuances du bleu depuis la turquoise jusqu’au saphir, et la baie toutes les nuances du vert depuis l’émeraude jusqu’à la chrysoprase. Aucune grâce ne manque à cette baie ; quand je regarde l’horizon qui l’enferme, c’est un lac ; quand je regarde la marée qui monte, c’est la mer. »…
« À Pasajes, village idyllique dans lequel les gens travaillaient, dansaient et chantaient, où la mer et la montagne se rejoignaient », « Les montagnes de Pasages ont pour moi deux attraits particuliers. Le premier, c’est qu’elles touchent à la mer qui à chaque instant fait de leurs vallées des golfes et de leurs croupes des promontoires. Le second, c’est qu’elles sont en grès. » …
« La maison que j’habite est à la fois une des plus solennelles qui regardent la rue, et une des plus gaies qui regardent le golfe. […]. La maison où je suis a deux étages et deux entrées. Elle est curieuse et rare entre toutes, et porte au plus haut degré le double caractère si original des maisons de Pasages. C’est le monumental rapiécé avec le rustique. C’est une cabane mêlée et soudée à un palais. »
Il partit ensuite pour Pampelune :
« Je suis à Pampelune et ne saurais dire ce que j’y éprouve. Je n’avais jamais vu cette ville, et il me semble que j’en reconnais chaque rue, chaque maison, chaque porte. Toute l’Espagne que j’ai vue dans mon enfance m’apparaît ici comme le jour où j’ai entendu passer la première charrette à bœufs. Trente ans s’effacent de ma vie : je redeviens l’enfant, le petit Français, “el niño”, “el chiquito francés”, comme on m’appelait. Tout un monde qui sommeillait en moi s’éveille, revit et fourmille dans ma mémoire. Je le croyais presque effacé ; le voici plus resplendissant que jamais. »
C’est sur la route du retour qu’Hugo apprit la mort tragique par noyade de sa fille Léopoldine (1824-1843).
Sources : Forum Universitaire ; La revue des deux mondes ; JSTOR et autres.
Datos
Quatre pays ont retenu l’attention d’Hugo : l’Espagne, l’Égypte, la Turquie et la Grèce.
Mais la place que l’Espagne occupe dans son œuvre et dans sa vie est sans commune mesure avec le temps réel qu’il y a passé.
Paul Hazard parle de «la hantise du rêve espagnol chez Victor Hugo» et l’Espagne, terre de volupté et de sang, de sérénade et de vengeance, l’Espagne catholique et mozarabe, l’Espagne des guitares et des palais mauresques se retrouve dans toute l’œuvre hugolienne notamment dans les Orientales.
Deux pièces sont fondées sur des intrigues espagnoles, Hernani, se situe dans l’Espagne de la Renaissance (1519), au début du règne de Charles Ier, jeune roi de 19 ans destiné à l’Empire. L’autre, Ruy Blas, prend place à Madrid en 1698, pendant le règne de Charles II. Comme le dit Hugo dans la préface de Ruy Blas, « Entre Hernani et Ruy Blas, deux siècles de l’Espagne sont encadrés […] Dans Hernani, le soleil de la maison d’Autriche se lève ; dans Ruy Blas, il se couche. »
* « Victor Hugo par un témoin de sa vie ». Le témoin est Adèle Foucher, l’épouse d’Hugo. Cette biographie a été écrite à Guernesey en 1863, en étroite collaboration avec Hugo lui-même, mais elle a été ensuite remaniée et censurée par leur fils Charles et par Auguste Vacquerie.
Le texte rétabli d’après les manuscrits est paru chez Plon, en 1985, sous le titre : « Victor Hugo raconté par Adèle ».
Patrice Quiot