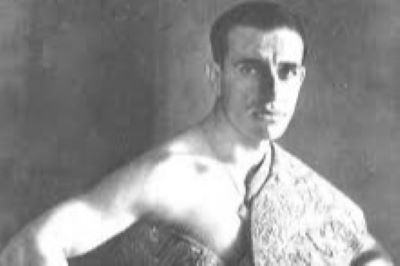Juan de sol ; Juan de sombra…
« Il est difficile de vivre au croisement de l’ombre et de la lumière, deux réalités si opposées. De provoquer, devant, la charge de la mort, pendant que derrière, le soleil vous chauffe la nuque. Suer au front peut paraître héroïque, mais une nuque moite de sueur demeure temporelle, profondément humaine. Si on est brave, on va jusqu’à s’agenouiller devant le taureau, le coude entre les deux cornes.
Mais le soleil, brave ou non, on ne le regarde jamais qu’en levant les yeux. Sans ménagement, sa lumière, comme l’épée, « fouille les yeux, les fait pleurer, entre dans le corps avec une rapidité douloureuse, le vide, l’ouvre à une sorte de viol tout physique, le nettoie en même temps » (Albert Camus).
Sur le diable lui-même, si le diable existe, le soleil l’emporterait.
C’est pourquoi Belmonte a préféré apprivoiser son art dans ce qu’il croyait être pourtant son élément : les ténèbres. Ainsi, après une dure journée de travail à la boutique de son père, le jeune Belmonte, accompagné de quelques fidèles, marchait plusieurs kilomètres, puis traversait un cours d’eau à la nage, pour parvenir jusqu’à l’élevage le plus proche, d’où il fallait encore isoler la bête élue pour l’emmener dans la clairière où elle serait combattue. Après quoi, au beau milieu de la nuit, à l’heure où les hommes sont rompus, Belmonte, poitrine nue et armé d’un leurre de fortune (une veste trempée), provoquait la fureur d’une bête qu’aucun picador n’avait calmée – sauf la lune, peut-être.
Toréer de nuit, on le devine, obligeait Belmonte à adopter une manière peu commune, qui consistait à accompagner le taureau avec la cape pendant toute sa charge et à ne jamais s’en détacher, de peur de voir la bête, toute puissante et imprévisible, s’enfoncer dans le noir. Cette manière suicidaire valut à Belmonte les étiquettes de « cadavre en sursis » et de « diamant brut ». On louait son courage, mais lui reprochait de toréer les bras trop près du corps. De la volonté, ce jeune homme en possédait plein, disait-on, mais en matière de technique, il était nul.
Il faut dire que sa méthode avait de quoi déconcerter : « Tu te mets là, tu ne t’enlèves pas et si tu sais toréer, même le taureau ne t’enlève pas. » Ce qui s’appelle « présenter hardiment au destin la face où il peut nous blesser ». Quand ce jeune homme se retrouvait dans l’arène, pour exceller contre le taureau, il lui fallait donc à tout prix se tirer vers le bas, s’enfoncer dans le sable jusqu’à ce que disparaissent foule et lumière. Faire table rase. Donner à ce théâtre hypocrite la face d’un monde vierge, tel une plaque d’ardoise, à redessiner à la craie. Fuir la lumière pour mieux vaincre le taureau :
« Qu’est-ce que j’avais fait ? confie Belmonte à son fidèle et opportun biographe à la suite du récit d’un de ses plus beaux triomphes. Simplement oublié le public, les autres toreros, moi-même, et jusqu’à mon adversaire, pour me mettre à toréer comme je l’avais fait tant de nuits, seul dans l’enclos, seul dans les pâturages, seul comme on dessine au tableau noir. »
Rien d’étonnant à ce que Belmonte ait obtenu ses plus grands triomphes contre le « dernier taureau, celui qui sort du toril quand la lumière commence à décliner » quand l’ombre pâlit et que la nuque du torero, devenue fraîche, prend peu à peu l’aspect sec du marbre des dieux. Parce qu’alors, celui qui définissait la corrida comme « la transposition olympienne d’un état d’esprit » à l’égal des dieux, croyait pouvoir ad vitam aeternam renverser l’ordre du jour.
Ce qu’il parvint à faire le 8 avril 1962, à l’âge de 69 ans, mais sans héroïsme, sans gloire, le plus humainement du monde. Cette dernière victoire ne fut ni la sienne ni celle de la mort, mais la victoire du soleil. Les ténèbres ne sont l’ennemi de personne. »
André Goulet.
« Un masque à la douleur. »
(Plateforme Erudit/ Quebec/Montréal)/ 1993.
Datos
Juan Belmonte García, né le 14 avril 1892 à Séville, mort le 8 avril 1962 à Utrera.
Débuts en novillada sans picadors : 24 juillet 1910 à Arahal (province de Séville).
Débuts en novillada avec picadors : 21 juillet 1912 à Séville.
Présentation à Madrid : 26 mars 1913.
Alternative : Madrid le 16 octobre 1913. Parrain « Machaquito ».
Premier de l’escalafón en 1919.
La carrière de Belmonte s’étend du début des années 1910 jusqu’en 1936, année où il prit une retraite définitive. Mais en réalité, la partie la plus glorieuse de sa carrière date de l’époque de sa rivalité avec son ami José Gómez Ortega « Joselito », de 1914 à la mort de celui-ci en 1920
« Allez vite le voir pendant qu’il en est encore temps, car il n’est pas possible de toréer de cette façon. » C’est ce que les aficionados orthodoxes disaient de Juan Bel-monte à l’époque de ses premiers triomphes, au printemps de 1912. Dix ou quinze ans plus tard, il devenait clair que la révolution belmontiste avait déjà donné à l’art tauromachique un visage nouveau, et les critiques d’aujourd’hui sont unanimes à penser que l’histoire de cet art se divise en deux grands chapitres : avant et après Belmonte.
À près de 70 ans, il tombe follement amoureux de la rejoneadora colombienne Amina Assís (1941-2018) qui avait cinquante ans de moins que lui. Désespéré de se voir repoussé, il se tire une balle dans la tête le 8 avril 1962 dans sa propriété d’Utrera. Mais il s’agirait d’une légende.
Très récemment, on a retrouvé au Mexique une lettre de l’un des meilleurs amis de Juan Belmonte, qui était avec lui la veille de sa mort, et qui raconte par le détail, à un correspondant au Mexique, la fin du torero. Belmonte s’est suicidé par peur de se voir vieillir, d’être physiquement diminué, de ne plus pouvoir monter à cheval, de ne plus se livrer à son sport favori l’acoso y derribo.
Manuel Chaves Nogales a rédigé une biographie de Belmonte, sous le titre Juan Belmonte, matador de toros.
La vie de Juan Belmonte a fait l’objet d’une adaptation cinématographique réalisée par Agustín Díaz Yanes, sortie le 5 mai 1995 en Espagne et le 26 mars 1997 en France sous le titre original « Belmonte ».
Patrice Quiot